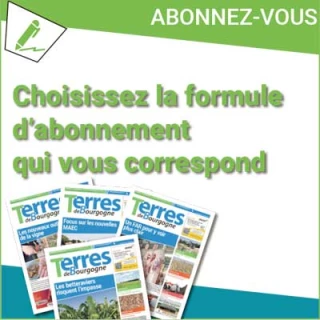Cinq regards de femmes
Le dernier Comité d'orientation transmission-installation de la Chambre d'agriculture de la Nièvre a fait une large place à la féminisation dans ce domaine. Cinq agricultrices ont apporté leur témoignage.

Ce sont les chiffres de la MSA Bourgogne qui le disent : en 2023, sur 589 installations effectuées en agriculture sur les quatre départements (Côte-d'Or, Yonne, Saône-et-Loire et Nièvre), 200 ont été le fait de femmes. Depuis 1970, en France, la part des femmes cheffes d'exploitation est passée de 8 à 34 %. Ces proportions n'ont rien d'anecdotique et justifiaient pleinement que le Comité d'orientation transmission-installation (Coti) de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, le 18 mars à Nevers, consacre une large part de ses échanges à la féminisation. Dans ce domaine, on navigue parfois en plein paradoxe, avec un nombre accru d'exploitantes et une persistance de préjugés sexistes. La réalité est complexe et nuancée. Cinq agricultrices nivernaises étaient invitées à apporter le témoignage de leur vécu et ce qui en ressortait traduisait le fait que leur quotidien échappe aux simplifications.
Rendre la féminisation banale
Les organisateurs du Coti ont, en guise d'introduction à ces témoignages, diffusé un échantillon du sexisme ordinaire auquel ces femmes peuvent être confrontées. Des phrases souvent négatives :
- « Tu es une fille, tu ne sais pas faire »
- « Les femmes n'ont pas leur place dans ce métier »
- « Il est là le patron ? »
Mais parfois positives :
- « Tu es courageuse pour être dans ce milieu »
- « Respect madame ! »
- « C'est semé beaucoup plus droit qu'un homme… »
Dans un cas comme dans l'autre, ces réactions mettent en relief le fait qu'aujourd'hui encore, pour beaucoup d'hommes, la place d'une femme en agriculture n'a rien de naturel ou de banal. Qu'en pensent Fanny Cadoux, Fanny Guillen, Mathilde Lafaye, Chantal Pelletier ou Camille Rouchon ? Toutes cinq apportaient leurs regards singuliers et assez éclairants, sur les évolutions sociétales du monde agricole sur ces questions, mais aussi sur les freins ou préjugés qui persistent. Pour Mathilde Lafaye, il y a un postulat de base : « les femmes ont raison de croire en elles. » Installée en 2013, en association avec son père, en maraîchage et épouse d'un agriculteur, elle doit « jongler » entre deux lieux de vie et de travail relativement éloignés : « Mon maître-mot c'est l'organisation, parce qu'on ne peut pas nier la charge mentale à laquelle on est confrontées. En tant que femme, on doit aussi parfois faire avec une certaine pression sociétale. » Installée en 2021 dans le Morvan, hors cadre familial, en élevage bovin et ovin, Fanny Guillen a très bien vécu son installation, avec son compagnon : « Je n'ai pas ressenti de sexisme et dans mon quotidien, je pense que j'aborde autrement les travaux de force. En tant que femme, on a toute notre place en agriculture, il faut juste oser. » « En apiculture, la question des muscles, c'est du pipeau ! déclare pour sa part Fanny Cadoux : l'important c'est l'organisation de travail et les objectifs qu'on se pose » souligne celle qui s'est installée, certes, avec son compagnon, mais dans un système où chacun a son exploitation. Une sorte de bon compromis entre association et indépendance.
C'est qui l'patron ?
Cette indépendance, justement, il faut parfois la gagner de haute lutte face à un univers agricole qui a encore du mal à concevoir qu'une femme puisse être cheffe d'exploitation. Exemple avec Camille Rouchon, 31 ans, installée en 2023 en élevage ovin, avec 110 brebis et l'objectif de monter à 150 prochainement : « Mon mari n'est pas agriculteur mais il me donne parfois des coups de main sur l'exploitation. J'ai un exemple assez frappant de préjugé sexiste presque banal, que j'ai vécu : lorsque j'ai voulu investir dans un valet de ferme, je me suis rendue chez un concessionnaire en machinisme agricole, avec mon mari. Le commercial que j'ai rencontré ne s'est adressé qu'à lui pendant toute la discussion… » Tous ces exemples faisaient parfois sourire mais doivent surtout nous interroger sur la difficulté de se débarrasser de constructions mentales un peu trop bien installées et dans lesquelles tout le monde, consciemment ou non, peut tomber. La valeur de l'exemple donné par ces cinq agricultrices est sans doute la meilleure réponse à apporter, comme le confirmait Chantal Pelletier. À 45 ans, elle s'est installée en polyculture-élevage après une première carrière dans l'agroalimentaire. Elle contribue à renforcer l'état d'esprit des générations futures dans ce domaine, en intervenant dans les collèges, mais aussi en accueillant des stagiaires : « Très souvent, avec elles, je constate qu'elles sont surprises de ce que je leur laisse faire, des responsabilités que je leur confie. Certaines ont peut-être intériorisé le fait qu'une fille, sur une exploitation, on va plutôt s'en méfier ou douter de ses capacités alors que moi, j'ai appris une chose : il faut prendre sa place et s'affirmer. »
Freins et actions
La MSA de Bourgogne a présenté, dans le cadre de ce Coti, les résultats d'une étude BVA réalisée en janvier 2024 auprès d'un peu plus de 1 000 femmes. Elle montre que si l'attachement des agricultrices à leur métier est fort, elles ressentent un manque de reconnaissance, pour 87 % d'entre elles. 77 % estiment entretenir de bonnes relations avec leurs collègues masculins. De son côté la MSA a identifié plusieurs freins à l'exercice des métiers agricoles par les femmes :
– le statut des non-salariées
– les imprévus liés à la vie de famille
– les risques spécifiques et l'éloignement des professionnels de santé
- l'accessibilité des matériels agricoles
– les constructions et représentations sociétales des responsabilités dans le monde agricole encore trop imprégné du modèle masculin.
En Bourgogne, la MSA envoie à toutes les conjointes collaboratrices des informations sur les évolutions possibles de ce statut. Elle cherche aussi à obtenir la parité au sein des commissions d'homologation du matériel agricole pour intégrer de nouveaux critères morphologiques. Enfin, elle mène des actions afin de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelles (cofinancement de nouvelles crèches ou de nouvelles places en crèches, promotion du métier d'assistante maternelle…)