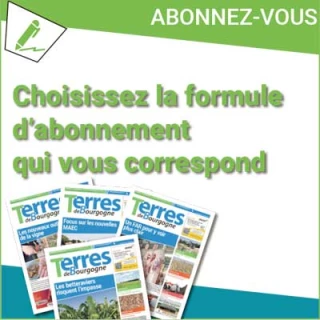Analyse de l'avenir de l'élevage bovin à viande
En décembre, l’économiste de l’Institut de l’élevage Philippe Chotteau était en Saône-et-Loire, à Charolles, invité de l’assemblée générale de la coopérative Avéal. À l’aube de 2022 et alors que la nouvelle Pac se dessine, il a livré sa vision pour l’avenir de l’élevage.

Invité de la dernière assemblée générale de la coopérative Avéal en décembre, le chef du département Économie de l’Institut de l’élevage (Idele) a donné un éclairage fort utile en cette période de bouleversement. Le bassin charolais s’apprête à affronter un nouveau système d’aide, mais aussi à subir les conséquences du Pacte Vert, sorte de défi environnemental imposé par l’Europe, sans oublier le plan de relance protéique. Tout cela intervenant dans un contexte de marché perturbé, avec une flambée des prix des matières premières, un revenu trop bas depuis des années, une décapitalisation sans précédent et une démographie des éleveurs inquiétante. « La décapitalisation des élevages sévit depuis cinq ans », notait Philippe Chotteau qui pointait aussi l’érosion démographique des éleveurs spécialisés avec le spectre d’ici 2030 du départ en retraite de la moitié des actuels chefs d’exploitation… « Dans dix ans, on devrait avoir perdu 600 000 vaches allaitantes en France et 200 000 rien que pour le nord Massif Central », poursuivait-il. Le bassin charolais est bien concerné par cette décapitalisation et, selon l’expert, la première des races à viande perdrait même plus que les autres (- 14 % en dix ans).
Les abattages se maintiennent
Bien que la consommation de viande bovine soit en baisse, la demande en viande bovine française résiste et le volume des abattages se maintient. Ce sont les volumes d’importation qui diminuent. « Dans un contexte de baisse du cheptel de production viande et lait, ce sont les animaux de la décapitalisation qui approvisionnent ce tonnage abattu », faisait remarquer Philippe Chotteau. Dans les actes d’achat, l’origine locale semble rassurer encore plus que le bio et la vente directe est en plein essor. Autre tendance lourde : la part de la viande hachée a progressé de 13 % entre 2017 et 2020. Avant le Covid, plus d’un tiers des carcasses bovines passait en haché. Cette part a augmenté depuis ce qui fait dire à l’économiste que la problématique du poids de carcasse perd de son importance, vu que de moins en moins de pièces de viande sont mangées entières. À ce propos, Philippe Chotteau révélait que la charolaise était celle qui s’était le moins alourdie depuis dix ans.
Opportunités sur le marché allemand
« Si la moitié des mâles produits continue d’être exportée en broutards, on relève une montée des exportations de broutardes, et ce en dépit de la demande en femelles de viande », pointait l’expert. L’Italie demeure le principal débouché des broutards français et les flux vers les pays tiers se maintiennent. Dans la viande, Philippe Chotteau évoquait de nouvelles perspectives sur le marché allemand, lequel délaisserait les viandes de porcs perçues comme très industrielles au profit du bœuf bénéficiant d’une image plus vertueuse. Mais cette demande est assortie d’exigences et de cahiers des charges (non OGM, bien-être animal, etc.). Pour compléter ce tableau, l’économiste évoquait l’explosion des prix : énergie, lubrifiants, matériel, bâtiments, fret… L’Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (Ipampa) est en hausse de 10 %. À cela s’ajoute la hausse du prix des engrais, l’envolée historique du prix des oléagineux et celles des tourteaux non OGM… Tout cela tandis que, « comme d’habitude, le prix de la viande ne suit jamais ! », reconnaissait Philippe Chotteau. « Si bien que le revenu des éleveurs reste mauvais depuis sept ans, avec un prix qui ne couvre pas le coût de production », convenait l’intervenant. Une injustice que les Égalim tentent de réparer, avec, notamment, l’instauration de la contractualisation.
Pac peu favorable
C’est dans cette situation difficile qu’intervient la nouvelle Pac dont la mise en place s’annonce « très compliquée ». En dépit d’un « budget relativement sauvé », les éleveurs subiront une Pac qui n’est « pas favorable aux bovins allaitants », synthétisait Philippe Chotteau. L’économiste de l’Idele révélait qu’avec ces nouvelles aides en baisse, le prix de revient au kilo d’une vache de réforme passerait de 5,10 € à 5,24 €. Un effort énorme devra donc être fait sur la rémunération du produit… De fait, avec la nouvelle Pac, les éleveurs allaitants perdront entre 11 et 30 % sur les aides couplées. Avec l’instauration d’un nouveau plafond, « le système n’incitera plus à capitaliser individuellement », si bien qu’une érosion du cheptel est attendue, estimait l’expert. Dans le même temps, les protéines végétales seront favorisées. Un paiement vert voit le jour basé sur un système d’éco-régimes. En clair, les éleveurs auront-ils intérêt à aller chercher ces nouvelles aides vertes ? Lesquelles peuvent passer par l’application du plan protéines végétales (lire encadré).
Changement de priorité
Au terme de cet exposé, Philippe Chotteau retient tout de même « un marché porteur ». En outre, le bovin français bénéficie de « sa bonne image ». Pour les éleveurs, l’économiste voit aussi « des perspectives dans la reconquête de l’autonomie protéique ». Mais, a contrario, « on ne voit pas de signaux pour stopper la décapitalisation ». Philippe Chotteau redoute un attrait accru pour les grandes cultures. « L’ombre des accords de libre-échange plane toujours, complétait-il. Une chose semble en tout cas acquise : la course à la productivité avec une génétique qui visait le seul alourdissement, c’est fini ». Les enjeux environnementaux, sociétaux et la Pac semblent opérer une rupture. Désormais, on irait vers des systèmes plus diversifiés… Dans les systèmes d’élevage, il faut désormais « travailler la productivité physique », incitait l’expert qui cible le nombre de veaux sevrés par vache, l’âge au premier vêlage, l’intervalle vêlage-vêlage. De la génétique, on attend qu’elle atténue la pénibilité du travail : vêlage, qualités maternelles, etc. « Il faut aussi soigner l’attractivité du métier », rappelle l’économiste. La qualité des produits est essentielle puisqu’il faut tenir compte, plus que jamais, des attentes des consommateurs, aussi contradictoires et farfelues soient-elles… Dans la continuité de la qualité, l’avenir de l’élevage passe aussi par une revalorisation du prix de vente de ses produits. Enfin, devant les adhérents majoritairement charolais d’Avéal, Philippe Chotteau assurait qu’il n’y avait « aucune raison d’aller chercher l’angus… ». En effet, pour lui, les races françaises ont toutes de quoi s’adapter grâce à leur diversité intrarace.
Aller chercher de la protéine
Sur la question de l’autonomie alimentaire, la France a pour objectif de doubler sa surface d’oléoprotéagineux et sa surface fourragère, indiquait Philippe Chotteau. Un objectif sur lequel planche l’Idele en menant des travaux sur l’autonomie protéique des élevages. Nombre de ces essais sont menés à la ferme expérimentale de Jalogny, en Saône-et-Loire. De ces travaux ressort qu’il faut développer la finition des animaux au pâturage, récolter des fourrages plus riches (fauches précoces), tout cela visant à limiter les achats de protéines. Il y a aussi un besoin en recherche sur les semences fourragères, pointait le représentant de l’Idele qui évoquait « un problème de communication pour toucher le plus grand nombre d’éleveurs ».