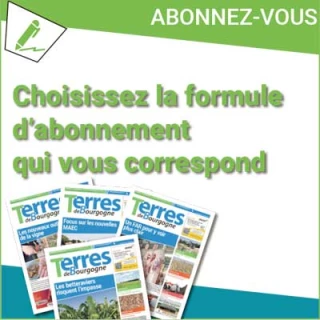À la reconquête des territoires ruraux
L’exode rural a rendu les territoires ruraux moins attractifs et a ainsi contribué au développement des zones commerciales situées en périphérie. Les experts estiment que ces dernières captent près de 72 % des dépenses des Français en magasin. Le pays semble pourtant connaître un regain d’installations de petits commerces au sein des villages et centres-bourgs. La cause ? Des initiatives, aussi bien publiques que privées, qui s’efforcent à encourager la reprise ou l’installation de commerces de proximité et lieux de convivialité dans les endroits les plus isolés.

Accès aux soins, à la culture ou encore à la mobilité… La ruralité cristallise de nombreux défis. À tel point que la désertification des commerces constitue une problématique souvent peu évoquée. Un chiffre parle pourtant de lui-même : en 2021, plus de 21 000 communes ne disposaient d’aucun commerce, soit 62 % d’entre elles. Ce taux était de 25 % en 1980. Un rapport d’activité du Sénat datant de mars 2022(1) notait même que la moitié des habitants vivant dans une commune rurale doit parcourir plus de 2,2 kilomètres pour atteindre une boulangerie. Selon Laurent Rieutort, géographe et directeur de l’Institut d’Auvergne du développement des territoires, les zones de commerce françaises se distinguent en quatre catégories. La première regroupe une offre variée et attractive, située dans des zones géographiques densément peuplées et résidentielles. La seconde, para-urbaine, se trouve en grande périphérie des villes et compte des habitants de catégories sociales professionnelles favorisées, gage de revenus élevés. La troisième correspond, quant à elle, à une zone intermédiaire avec des petites villes et des bourgs marqués par des migrations pendulaires de travail et au sein desquelles les commerces se stabilisent. La dernière catégorie est celle de la ruralité dite « de l’éloignement », où beaucoup de logements sont vacants. Pour Michaël Pouzenc, professeur de géographie à l’université de Toulouse 2 et directeur de recherche, la désertification des commerces reste entière au sein de cette dernière catégorie, tandis qu’une amélioration est notable dans les ruralités de densité intermédiaire. « Si nous prenons le cas de l’agglomération de Besançon, nous observons une augmentation sensible du nombre de points de vente dans l’espace périurbain, ainsi qu’une polarisation et une dispersion de l’offre ». Selon le professeur, ce territoire démontre le phénomène de « mise au quart d’heure des courses alimentaires ». « Quand le consommateur fait face à des problèmes de congestion routière, il préfère éviter l’hypermarché et privilégier des achats dans des commerces situés à proximité de chez lui ».
Un criant manque de financements
Un constat confirmé par la Fédération du commerce et de la distribution (FCD). Cette dernière note une hausse de l’activité des magasins de proximité ruraux et, notamment, des supérettes. La situation semble, en revanche, plus difficile pour les bars et les cafés. Le nombre de licences IV est passé de 200 000 en 1960 à environ 40 000 aujourd’hui. Croissance de la vacance commerciale, locaux fermés et parfois même abandonnés… Les conséquences sont sans appel et donnent parfois l’impression d’un cadre de vie dégradé. Autre problématique de taille, notifiée par les sénateurs : « Les petites communes rurales souffrent, entre autres, du fait que les commerçants encore présents ne trouvent pas de repreneurs lorsqu’ils cessent leur activité (…) Au-delà des raisons purement structurelles, telles que l’absence de clientèle et la baisse de la démographie, un manque de formation des repreneurs et des moyens financiers trop limités ont notamment été relevés ». Conscient de l’urgence de la situation, le gouvernement a lancé, en février 2023, un dispositif de soutien à l’installation de commerces dans les communes qui en sont dépourvues, ou dont les derniers commerces ne répondent plus aux besoins de première nécessité de la population. Gérée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et disposant d’un budget de 36 millions d’euros sur trois ans, cette aide vise les dépenses d'investissement dans des projets d’installation de commerces, dont le modèle économique est jugé viable. Parallèlement, les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) permettent aux collectivités de consentir l’exonération de certaines taxes locales. Ce dispositif touche actuellement 14 114 communes, dont 88 % possèdent moins de 500 habitants. Au-delà de ces soutiens mis en place par les pouvoirs publics, de nombreuses initiatives existent afin d’aider à la création ou à la reprise de commerces en milieu rural. Elles ont pour nom Ville à Joie, Bouge ton Coq, 1 000 cafés, Bistrot de pays, Villages Vivants (lire ci-dessous), Villages d’avenir… À titre d’exemple, Bouge ton Coq soutient les associations locales qui décident de prendre en charge un commerce, tandis que le programme 1 000 cafés accompagne et soutient des cafés multiservices dans les communes de moins de 3 500 habitants. Autant d’initiatives locales qui laissent entrevoir un renouveau pour les communes en manque de lien social, d’offres de services et de commerces.
(1) Rapport d’information du Sénat « attractivité commerciale en zones rurales », par Bruno Belin et Serge Babary, mars 2022.