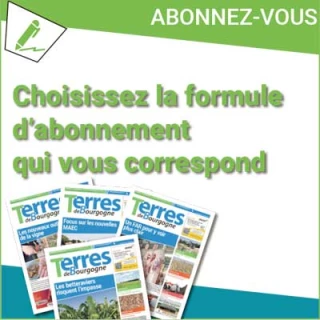La Chambre en session
Le photovoltaïque oui, mais pas à n’importe quelles conditions
Lors de sa session du 25 février, la Chambre d’agriculture de la Nièvre a marqué sa volonté de développer l’agrivoltaïsme (production photovoltaïque au sol couplée à une production agricole), en recherchant une synergie de fonctionnement.

« La production d’énergie renouvelable photovoltaïque se fait déjà, via des initiatives privées entre développeurs et propriétaires. Qu’on le veuille ou non, ces projets vont se multiplier, d’ailleurs la Chambre d’agriculture est sollicitée toutes les semaines pour ce type d’initiative. Alors autant que cela se fasse avec la profession agricole, pour un retour des recettes agrivoltaïques aux agriculteurs, dans le cadre que la profession aura fixé » expliquait Didier Ramet, président de la Chambre d’agriculture de la Nièvre, lors de la session du 25 février.
La France s’est fixée de très ambitieux objectifs en termes de développement d’énergies renouvelables. La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) établit des objectifs de production de 44,5 Gigawatts d’ici 2028. L’agriculture contribue très fortement à la production d’énergies renouvelables via l’éolien et les biocarburants (respectivement à hauteur de 83 et 96 %), elle peut donc grandement contribuer au développement photovoltaïque.
Forte demande nationale
Actuellement seulement 13 % de la production solaire photovoltaïque est agricole. Rappelons également que la France ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Si le potentiel de développement du photovoltaïque agricole est important, il ne peut pas se faire à n’importe quelles conditions. La Chambre d’agriculture a ainsi mis en place depuis septembre 2019 une commission dédiée à l’étude des conditions de mise en place de projets photovoltaïques au sol dans le département, d’où il émerge une conviction : ces projets doivent se tenir à la condition qu’ils soient rémunérateurs pour les agriculteurs. Plusieurs garde-fous ont ainsi été proposés par la commission et approuvés lors de la session. Le projet ne devrait être possible que si les parties prenantes sont favorables : commune, communauté de communes, Conseil départemental, État, Chambre d’agriculture.
Moins de 1 % de la SAU concerné
La Chambre valide donc le principe de limiter les parcs solaires nivernais à 2 000 Mégawatts (ce qui représente entre 2 000 et 3 000 hectares, soit moins de 1 % de la surface agricole utile départementale), avec une répartition par territoire des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour répondre à l’enjeu d’équité de distribution des recettes fiscales générées par l’agrivoltaïsme. « Il s’agit d’équilibrer les choses pour que tous les territoires nivernais bénéficient de projets, avec trois critères : la SAU, le nombre d’agriculteurs, le nombre d’habitants » explique Didier Ramet. De même, chaque parc photovoltaïque ne pourra excéder 70 ha, et ne pourra représenter plus de 50 % de la SAU d’un exploitant. À noter que les 70 ha peuvent être répartis entre plusieurs exploitations. L’agrivoltaïsme impose la mise en place d’une production agricole combinée aux panneaux. Cette nouvelle manière de produire impose un suivi technico-économique dans le temps.
Retombées financières individuelles et collectives
« L’exploitant doit être gagnant, nous voulons à tout prix éviter que les projets ne rémunèrent que les opérateurs » précise Didier Ramet. L’agrivoltaïsme doit être une double source de rémunération : à l’échelle individuelle pour les agriculteurs concernés par la centrale photovoltaïque sur leurs parcelles, mais aussi à l’échelle collective, de façon à alimenter un Groupement d’utilisation de financements agricoles (Gufa), qui aura vocation à financer des projets agricoles de territoire. En effet, selon la proposition élaborée par la Chambre d’agriculture, le développeur de la centrale photovoltaïque devra verser 1 000 euros/an/ha à l’exploitant agricole pour la conduite de ses surfaces en agrivoltaïsme. De même qu’il devra contribuer au financement du Gufa à hauteur de 1 500 euros/mégawatt/an pour l’utilisation de terres agricoles. Le Gufa est une structure permettant de capitaliser des fonds afin de financer des projets agricoles. « Demander à l’opérateur une participation au Gufa, c’est en quelque sorte garantir une forme de répartition des rentrées financières permises par l’agrivoltaïsme, afin qu’il ne profite pas qu’à quelques-uns ». De plus, les collectivités territoriales et le département, qui perçoivent des retombées fiscales de ces projets, sont invités à en reverser la moitié au Gufa pour soutenir les projets agricoles.
La France s’est fixée de très ambitieux objectifs en termes de développement d’énergies renouvelables. La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) établit des objectifs de production de 44,5 Gigawatts d’ici 2028. L’agriculture contribue très fortement à la production d’énergies renouvelables via l’éolien et les biocarburants (respectivement à hauteur de 83 et 96 %), elle peut donc grandement contribuer au développement photovoltaïque.
Forte demande nationale
Actuellement seulement 13 % de la production solaire photovoltaïque est agricole. Rappelons également que la France ambitionne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Si le potentiel de développement du photovoltaïque agricole est important, il ne peut pas se faire à n’importe quelles conditions. La Chambre d’agriculture a ainsi mis en place depuis septembre 2019 une commission dédiée à l’étude des conditions de mise en place de projets photovoltaïques au sol dans le département, d’où il émerge une conviction : ces projets doivent se tenir à la condition qu’ils soient rémunérateurs pour les agriculteurs. Plusieurs garde-fous ont ainsi été proposés par la commission et approuvés lors de la session. Le projet ne devrait être possible que si les parties prenantes sont favorables : commune, communauté de communes, Conseil départemental, État, Chambre d’agriculture.
Moins de 1 % de la SAU concerné
La Chambre valide donc le principe de limiter les parcs solaires nivernais à 2 000 Mégawatts (ce qui représente entre 2 000 et 3 000 hectares, soit moins de 1 % de la surface agricole utile départementale), avec une répartition par territoire des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour répondre à l’enjeu d’équité de distribution des recettes fiscales générées par l’agrivoltaïsme. « Il s’agit d’équilibrer les choses pour que tous les territoires nivernais bénéficient de projets, avec trois critères : la SAU, le nombre d’agriculteurs, le nombre d’habitants » explique Didier Ramet. De même, chaque parc photovoltaïque ne pourra excéder 70 ha, et ne pourra représenter plus de 50 % de la SAU d’un exploitant. À noter que les 70 ha peuvent être répartis entre plusieurs exploitations. L’agrivoltaïsme impose la mise en place d’une production agricole combinée aux panneaux. Cette nouvelle manière de produire impose un suivi technico-économique dans le temps.
Retombées financières individuelles et collectives
« L’exploitant doit être gagnant, nous voulons à tout prix éviter que les projets ne rémunèrent que les opérateurs » précise Didier Ramet. L’agrivoltaïsme doit être une double source de rémunération : à l’échelle individuelle pour les agriculteurs concernés par la centrale photovoltaïque sur leurs parcelles, mais aussi à l’échelle collective, de façon à alimenter un Groupement d’utilisation de financements agricoles (Gufa), qui aura vocation à financer des projets agricoles de territoire. En effet, selon la proposition élaborée par la Chambre d’agriculture, le développeur de la centrale photovoltaïque devra verser 1 000 euros/an/ha à l’exploitant agricole pour la conduite de ses surfaces en agrivoltaïsme. De même qu’il devra contribuer au financement du Gufa à hauteur de 1 500 euros/mégawatt/an pour l’utilisation de terres agricoles. Le Gufa est une structure permettant de capitaliser des fonds afin de financer des projets agricoles. « Demander à l’opérateur une participation au Gufa, c’est en quelque sorte garantir une forme de répartition des rentrées financières permises par l’agrivoltaïsme, afin qu’il ne profite pas qu’à quelques-uns ». De plus, les collectivités territoriales et le département, qui perçoivent des retombées fiscales de ces projets, sont invités à en reverser la moitié au Gufa pour soutenir les projets agricoles.
Un travail collectif
Didier Guyon, en charge du dossier photovoltaïque à la Chambre d’agriculture de la Nièvre et du dossier Énergies renouvelables, explique la méthode de travail choisie. « Pour définir un cadre sur l’agrivoltaïsme, nous avons réuni une commission d’élus Chambre, une vingtaine ont participé aux travaux. Nous avons fait 7 réunions sur 18 mois. Nous avons rencontré des agriculteurs et des développeurs, des maires, ce qui nous a permis d’alimenter les travaux de la commission. Cette dernière a rencontré une vingtaine d’opérateurs pour comprendre les logiques de fonctionnement et de rentabilité des parcs solaires. Il reste des points en suspens, nous assumons d’avancer en marchant, en essayant de sécuriser l’avancée de la démarche. Sa réussite nécessite notamment une coordination et une vision partagée avec les collectivités. Elles verront sûrement d’un bon œil que la profession amène des opportunités de recettes, plutôt que de venir chercher des aides ! Le Gufa peut être un vrai levier de développement de projets par et pour les agriculteurs. Avec les sécheresses successives, nous pourrions par exemple, imaginer de créer des retenues d’eau collectives, pour sécuriser l’irrigation, l’abreuvement, les récoltes… Si produire et vendre de l’énergie nous permettait à terme de garder notre fonction de production nourricière, de pérenniser nos modèles d’exploitation, alors nous aurons gagné notre pari ! »